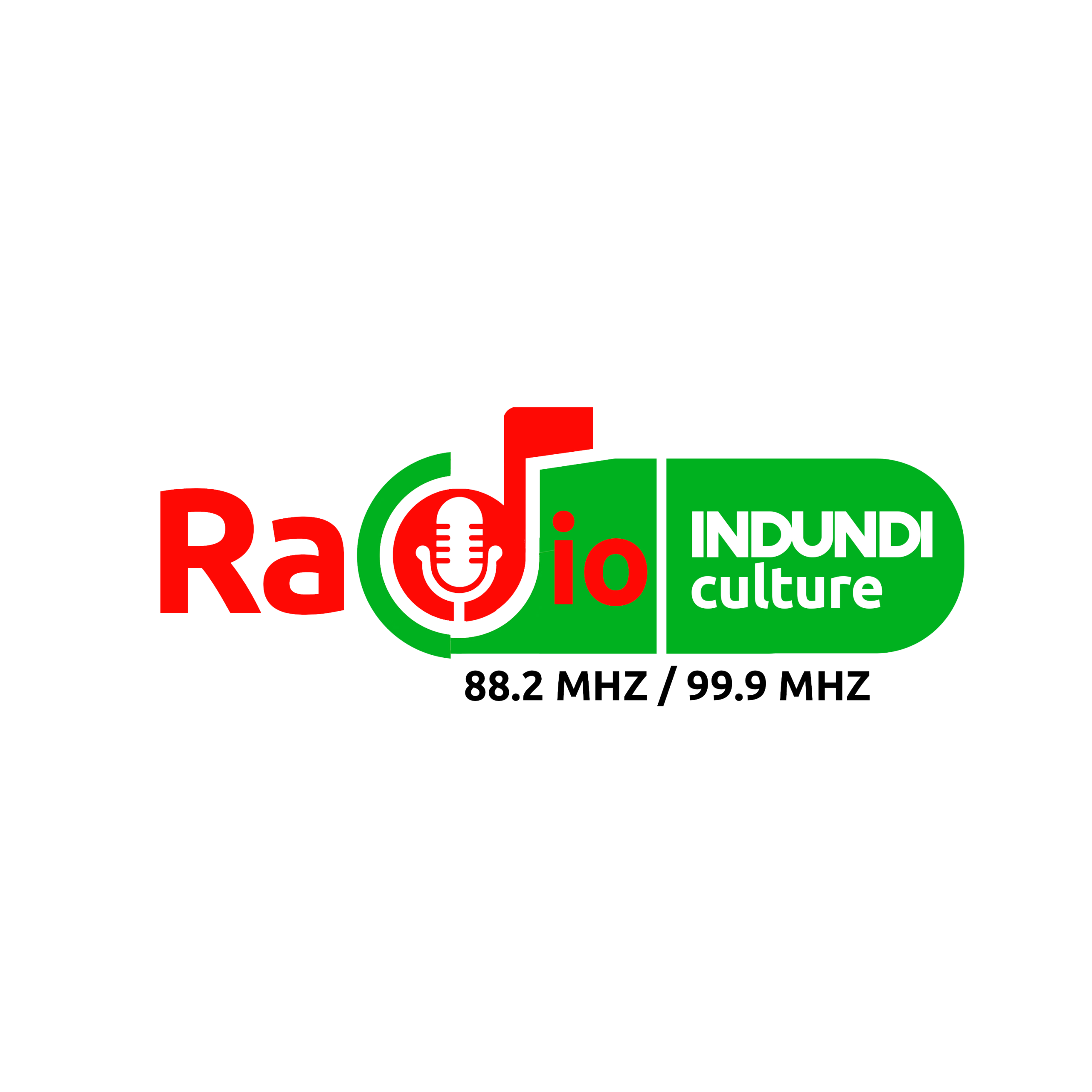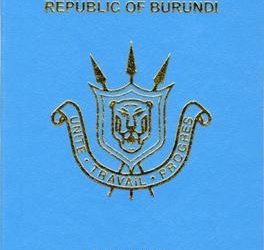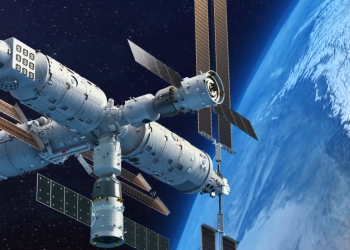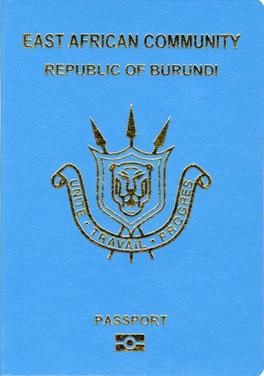La danse puissante et engagée de DeLaVallet Bidiefono ouvrait la 33e édition des Francophonies en Limousin avec TRANS de Julien Mabiala Bissila. Elle l’a refermée avec On ne brûle pas l’enfer, où l’on retrouve un comédien et deux musiciens du collectif limougeaud Zavtra.
En décembre dernier, les jeunes comédiens de ce groupe issu de l’Académie de théâtre de Limoges sont allés se confronter à la réalité congolaise. Dans l’espace Baning’Art créé à Brazzaville par DeLaVallet Bidiefono, ils ont rencontré les danseurs de la compagnie Baninga. Entre autres Destin Bidiefono – le frère de DeLaVallet –, Cognes Mayoukou et Aïper Moudou, qui partagent avec cinq d’entre eux le plateau de TRANS. Et Drevy Foundou Aïpeur, qui dans On ne brûle pas l’enfer danse sur les mots de Sony Labou Tansi. Dans ce spectacle à la distribution mixte, le chorégraphe et danseur congolais entend dire l’énergie de la jeunesse congolaise. Son désir de lutter contre la dictature, en posant notamment des actes créatifs d’autant plus forts qu’ils émergent dans un contexte de guerre. Sur un plateau nu à l’exception d’une grosse pierre, Drevy Foundoun Aïpeur se livre à une chorégraphie tendue. Il tombe et se relève. Trébuche puis se remet à courir, tête haute et torse bombé. Nourrie des allers-retours de DeLaVallet Bidiefono entre France et Congo et de ses nombreux voyages, cette pièce aux multiples renaissances est un message d’espoir qui a vocation à parcourir le monde. Rencontre en fin de Francophonies en Limousin, un des premiers festivals français à avoir coproduit un spectacle de DeLaVallet Bidiefono en 2009.
Le Point Afrique : Vous avez à de nombreuses reprises collaboré en tant qu’interprète avec des metteurs en scène occidentaux comme David Bobée, David Lescot ou encore Sara Llorca. Avant TRANS et On ne brûle pas l’enfer, vous n’aviez par contre jamais dirigé d’artistes occidentaux. Cette première a-t-elle un sens particulier pour vous ?
DeLaVallet Bidiefono : Ces deux créations sont avant tout le fruit d’une rencontre. Lorsqu’ils sont venus à Brazzaville en décembre dernier avec Julien Mabiala Bissila, les comédiens du collectif Zavtra se sont tout de suite mélangés aux artistes locaux. Ils ont mis des pagnes et sont allés jouer devant les bars. On avait jamais vu ça chez nous. Je crois qu’il est important que la jeunesse porte des représentations nouvelles, et un désir de construire un futur à partir d’une réconciliation entre France et Afrique. Sur scène par contre, je ne cherche pas spécialement à traiter de la mixité. Je travaille avec des artistes, avec des corps, sans me préoccuper de leur origine ni de leur couleur.
Vous parlez de futur, pourtant l’interprète de On ne brûle pas l’enfer danse sur des textes de Sony Labou Tansi écrits il y a plus de trente ans…
La dictature imaginaire que décrit Sony Labou Tansi dans La Vie et demie (Le Seuil, 1979), dont Stéphane Bensimon et Jean-Baptiste Tur du collectif Zavtra m’ont aidé à choisir des extraits pour le spectacle, fait autant penser à l’époque de Mobutu qu’à aujourd’hui. Aussi bien au Congo qu’ailleurs, car Sony Labou Tansi n’a pas seulement écrit pour son pays mais pour le monde, qui ne va pas mieux en 2016 que dans les années 80. La place de Sony dans l’imaginaire congolais est majeure, aussi bien pour sa génération que pour la mienne. Il faut perpétuer sa mémoire.
Vous vous placez donc d’une certaine manière dans la filiation de Sony Labou Tansi, comme le fait Dieudonné Niangouna dans son théâtre. Est-ce à dire qu’en danse contemporaine, il n’existe pas ce type de filiation ?
En effet, nous n’avons pas au Congo l’équivalent d’une Germaine Acogny au Sénégal ou d’un Salia Sanou au Burkina. De nombreux danseurs traditionnels ont quitté le pays et se sont mis au contemporain en France et aux États-Unis. À Paris, il y a Chrysogone Diangouaya, qui a créé un centre de danse. Il existe pourtant près de 150 compagnies de danse aujourd’hui au Congo : les jeunes veulent s’exprimer autrement que par la violence, et il faut les soutenir dans cette voie. C’est pourquoi j’ai créé l’espace Baning’Art à Brazzaville, et que je continue d’aller travailler régulièrement avec les danseurs qui se servent du lieu pour chercher et pour créer. Je ne veux pas qu’ils connaissent la même solitude que les danseurs de ma génération. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir la même chose, et pas seulement dans le milieu de la danse. Je travaille par exemple beaucoup avec Dieudonné Niangouna dont vous parliez, qui a créé le festival Mantsina. Cette dynamique est assez neuve, car il y a encore 25 ans, peu d’artistes collaboraient dans nos pays.
On ne brûle pas l’enfer est d’ailleurs un spectacle de transmission. Pouvez-vous nous présenter Drevy Foundoun Aïpeur ?
Aïpeur est issu de l’école que j’ai créée à Brazzaville, il y a quelques années. Il vient de Pointe-Noire, et a rejoint la compagnie pour élargir les bases qu’il avait acquises chez lui, où il s’était initié au hip-hop. Il a très vite pris de l’autonomie, et a commencé à faire ses propres performances. Quand il est arrivé, on n’avait pas encore de lieu. On travaillait dans les ruelles, dans les buissons ; il fallait en vouloir et lui en voulait. Quand je l’ai senti mûr, j’ai voulu que le monde le voie. Il fera aussi partie de ma prochaine création, avec neuf autres danseurs et des batteries, et il est en train d’écrire son premier solo. Je forme des personnes susceptibles de devenir des générateurs. Nous avons besoin d’énergies vives pour continuer à développer notre art.
Ses chutes et les tremblements, dans votre pièce, semblent dire la difficulté qu’il y a à simplement « continuer ». La danse ne peut-elle dire que sa propre fragilité ?
Plus que les chutes, c’est la capacité à s’en relever qui m’intéresse. À l’image de la jeunesse congolaise, qui prend son destin en main malgré les bombes, mes danseurs recommencent sans cesse. Bien sûr, cette volonté forcenée n’est pas sans fragilité. Nous avons tous perdu des proches dans la guerre, et nos corps sont marqués par cette épreuve. Danser, pour moi, c’est dire la force et la faiblesse en un seul geste. Situé dans un quartier du sud de Brazzaville complètement détruit pendant la guerre, l’espace Baning’Art porte ce paradoxe. Quand les habitants sont revenus pour construire leurs maisons, l’école a poussé avec elle. Aujourd’hui, cette zone est à nouveau touchée par la guerre. On ne peut plus y travailler, mais on tient bon. Et j’espère bien pouvoir écrire un jour des spectacles qui parlent d’autre chose que de guerre. D’amour, par exemple…

Les interprètes du collectif Zavtra ont-ils réussi à s’approprier cette réalité si loin de leur quotiden d’artistes ?
Depuis les attentats, la violence a fait irruption dans le quotidien français. Si les réalités française et congolaise sont en effet très différentes, je crois que ça a créé un rapprochement. Le texte de Sony a beaucoup résonné chez les artistes de Zavtra. Ils y ont reconnu leurs peurs. Il y a une chose par contre que le comédien ne saisissait pas : pourquoi il devait répéter qu’il est seul. Sur place, il a compris. Chez nous, le danseur se forme et travaille dans l’isolement. La danse contemporaine a longtemps été vue comme la danse du Blanc. Cela commence à changer, mais il y a encore du chemin à faire.
LePoint