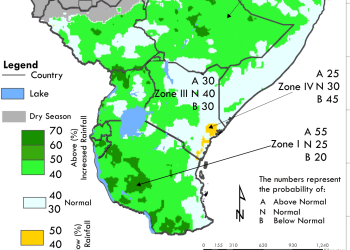Alors que la corruption semble gagner du terrain au Burundi, des voix de la société civile, d’experts et d’hommes politiques s’élèvent pour dénoncer l’inaction des autorités et l’affaiblissement des mécanismes de contrôle. Face à la pression, le président de la République promet la création d’une agence nationale de lutte contre ce fléau, mais des doutes subsistent quant à son efficacité.
Le mercredi 30 juillet 2025, lors d’une émission en synergie sur la lutte contre la corruption, plusieurs voix issues de la société civile, du monde académique et de la classe politique ont dénoncé l’affaiblissement des mécanismes de lutte contre la corruption au Burundi.
Gabriel Rufyiri, président de l’OLUCOME (Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Économiques), a déploré un recul alarmant dans la lutte contre la corruption. Pour lui, le signal fort a été donné lorsque le ministère en charge de la bonne gouvernance a été supprimé par le président actuel.
« Ce ministère, que nous considérions déjà comme un tigre en papier, représentait malgré tout une volonté politique. Aujourd’hui, nous pensons que la lutte contre la corruption a été tout simplement abandonnée », regrette-t-il.
Il dénonce également la non-application des conventions internationales pourtant ratifiées par le pays, comme celle des Nations Unies contre la corruption.
Une réalité confirmée par les experts
L’économiste et professeur Diomède Ninteretse confirme ce constat à travers des chiffres et des rapports officiels. Il cite notamment le rapport de Transparency International, qui révèle un taux de perception de la corruption de 68 % en 2022. La Banque mondiale classe également le Burundi parmi les 162 pays les plus touchés par la corruption.
« La corruption est une réalité au Burundi, visible dans presque tous les secteurs », affirme-t-il.
Il pointe du doigt l’opacité dans la passation des marchés publics, souvent sans appel d’offres, ainsi que la corruption dans le secteur de la justice.
« Le manque de transparence et l’impunité sont devenus monnaie courante. Le pays reste à la traîne en matière de bonne gouvernance », déplore-t-il.
Une culture de la corruption ?
Francis Rohero, président du parti d’opposition FPI, va plus loin en parlant d’une corruption enracinée dans le quotidien des Burundais.
« La corruption atteint un niveau inquiétant. Dans presque tous les services, les citoyens doivent verser des pots-de-vin. Cela devient une habitude, voire une culture », s’indigne-t-il.
Il constate également que la lutte contre ce fléau s’est affaiblie depuis 2020, malgré la création de la brigade anti-corruption en 2007 et les promesses politiques.
« Ces institutions en charge de lutte contre la corruption manque encore de moyens, cela est lié au manque de la volonté politique de bien équiper ces institutions » insiste-il.
Des promesses au plus haut niveau de l’État
Conscient de la gravité de la situation, le président Évariste Ndayishimiye a reconnu, lors du lancement de la Semaine de la diaspora, que la corruption touche même les plus hautes sphères de l’État.
« Imaginez : même mon propre conseiller a été emprisonné pour corruption », a-t-il révélé.
Le chef de l’État a annoncé la prochaine création d’une Agence nationale de lutte contre la corruption, qui inclura à la fois des Burundais de la diaspora et des représentants des institutions nationales.
« La corruption me tient vraiment à cœur. Je cherche sans cesse comment l’éradiquer », a-t-il insisté, évoquant notamment le cas d’un juge pris en flagrant délit grâce à un piège tendu par la présidence.
Si la promesse présidentielle a été saluée, les acteurs de la société civile appellent à la vigilance. Pour Gabriel Rufyiri (OLUCOME) et Francis Rohero (FPI), cette agence ne sera efficace que si elle est composée de personnes intègres, indépendantes du pouvoir politique.