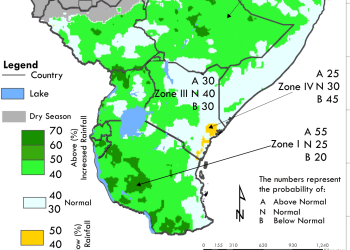Alors que la population burundaise croît à un rythme soutenu, la planification familiale demeure un sujet sensible et peu maîtrisé. Dans la province de Makamba, entre prise de conscience, croyances religieuses et craintes liées aux méthodes modernes, les efforts de sensibilisation se heurtent encore à de nombreux obstacles.
Alors que la population burundaise connaît une croissance rapide, la planification familiale reste un enjeu crucial mais encore trop peu pris en compte. Dans la province de Makamba, au sud du pays, des femmes et des hommes prennent conscience de l’importance d’espacer les naissances. Cependant, l’adoption des méthodes contraceptives médicales demeure limitée.
Une prise de conscience progressive dans les communautés
Certaines familles reconnaissent que limiter le nombre d’enfants permet de mieux les élever.
« Faire des enfants selon ses moyens, c’est leur garantir à manger et une scolarité », confie Rose Shimikiya, mère de trois enfants à Mabanda.
De son côté, Jean Bosco Nzoyihéra, de la colline Mbizi, souligne les conséquences sociales des familles nombreuses : « Quand les ressources manquent, les enfants sont plus vulnérables, certains sombrent dans le vol ou la malnutrition. »
Des méthodes modernes encore peu acceptées
Malgré les efforts des agents de santé communautaire, la méfiance persiste. Fidélité Niyongendako, en poste à Bikobe, explique :
« Beaucoup refusent les méthodes médicales, croyant qu’elles visent à freiner notre reproduction. Mais ceux qui les acceptent préfèrent les injections et les implants. »
Une fréquentation timide des centres de santé
Au centre de santé de Gitara, l’infirmière Alice Ndayisaba observe une fréquentation encourageante mais encore faible :
- 50 femmes choisissent les injections chaque mois
- 3 à 4 optent pour l’implant
- Une dizaine se tournent vers le stérilet
- Près de 20 utilisent les pilules
Elle insiste sur les avantages : « Ces méthodes permettent un allaitement optimal, une meilleure santé pour la mère et l’enfant, et plus de temps pour les responsabilités économiques. »
Mais elle met aussi en garde : « Les grossesses rapprochées augmentent le risque de décès maternel ou infantile. »
Une démographie qui inquiète
Le Burundi compte aujourd’hui plus de 12 millions d’habitants, contre 8 millions en 2008. Avec un taux d’accroissement de 2,7 % par an, cette croissance exerce une pression sur les ressources nationales.
Selon une étude de 2017 sur la santé reproductive :
18 % des Burundais avaient besoin de méthodes contraceptives en 2016 sans y avoir accès (contre 15 % en 2010)
Seuls 23 % utilisaient effectivement une méthode contraceptive
Le rôle ambivalent des religions
Le gouvernement reconnaît l’importance des confessions religieuses dans la sensibilisation, mais toutes ne soutiennent pas les méthodes modernes. L’islam se montre plus ouvert, tandis que plusieurs Églises chrétiennes les rejettent encore.
Ajoutons à cela une culture qui valorise les familles nombreuses : en moyenne, une femme burundaise donne naissance à cinq enfants, selon la même étude.
Une transition lente, mais indispensable
Le Programme national de santé reproductive milite pour une adoption plus large des méthodes médicales, considérant que l’abstinence seule est insuffisante face aux défis du pays.
La planification familiale ne relève pas uniquement de la santé : c’est une question de développement, d’égalité et de dignité. Tant que les barrières culturelles, religieuses et structurelles ne seront pas surmontées, le défi restera entier.